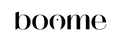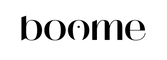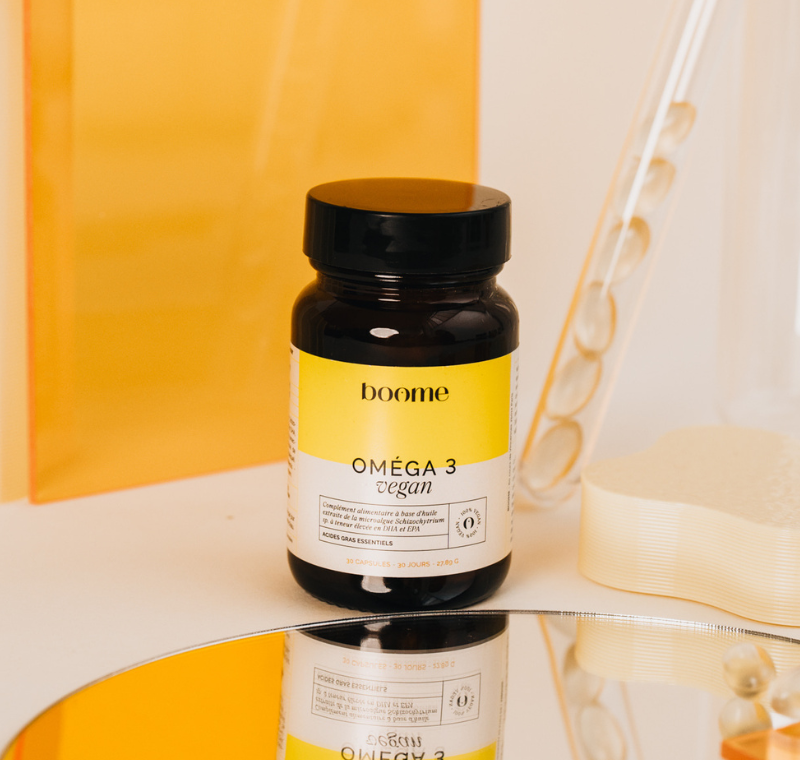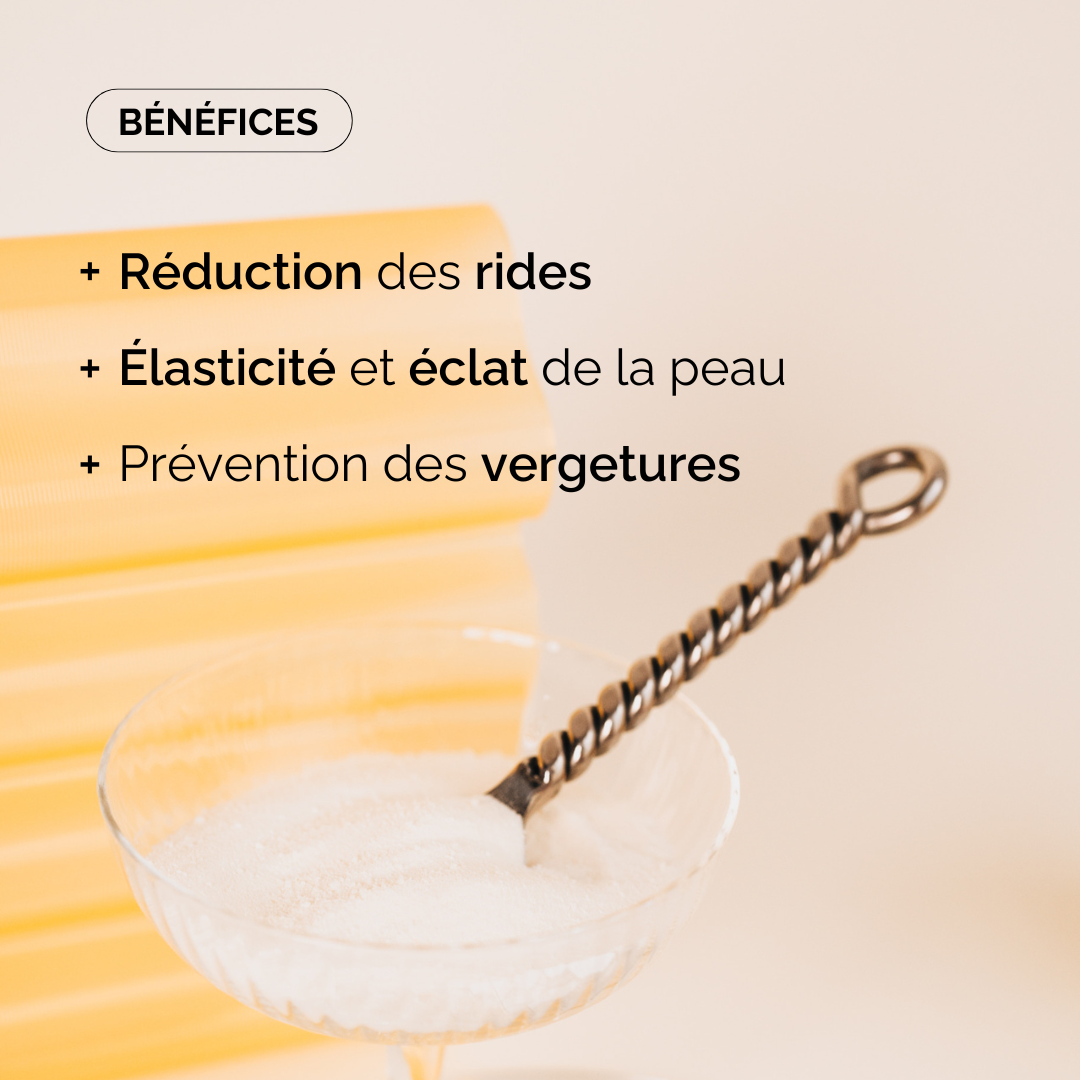Un jour, vos règles deviennent irrégulières. Le mois suivant, vous vous réveillez trempée de sueur. Puis viennent les insomnies, les oublis, l’impression de perdre pied. Et si ce n’était pas « le stress », mais le début d’une nouvelle phase hormonale ? La périménopause touche toutes les femmes, mais peu savent ce qui se joue dans leur corps. Ce n’est pas une panne, ni une fatalité. C’est une transition — puissante, complexe, hormonale. Alors, quel est le lien entre périménopause et hormones ? Dans cet article, on vous explique ce qui change vraiment et comment traverser cette étape en conscience.
Avant de parler hormones, qu’est-ce que la périménopause ?
La périménopause, c'est une phase de transition hormonale naturelle de la vie des femmes qui précède la fameuse ménopause. Elle peut débuter dès la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, bien que la majorité d'entre nous commencent à en ressentir les effets autour de 45 ans. Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas un événement brutal ! Mais un processus progressif, qui s'étale souvent sur plusieurs années.
Durant cette période de transition ménopausique, les fluctuations hormonales peuvent frapper fort. Eh oui, les ovaires commencent à ralentir leur production hormonale — notamment celle des œstrogènes et de la progestérone. Mais attention : cette baisse n’est ni linéaire ni constante ! Elle se fait par vagues, avec des phases de variations parfois déroutantes. Voilà qui explique pourquoi les symptômes peuvent apparaître de manière irrégulière et varier d’une femme à l’autre.
La périménopause correspond donc au moment où le cycle menstruel commence à se dérégler. Sans que la ménopause (qui, elle, équivaut à l'arrêt définitif des règles pendant 12 mois consécutifs) ne soit encore installée. Les flux deviennent plus irréguliers, parfois plus abondants. La durée des cycles est de plus en plus espacée. Certaines femmes n’y prêtent d'ailleurs pas immédiatement attention ! Et attribuent les premiers signes de la périménopause à du stress, de la fatigue ou une surcharge mentale.
Pourtant, ce qu'on ressent ne se trouve pas « dans la tête », mais est bien lié à une réalité hormonale. Accepter cette phase, c'est donc se permettre de mieux la vivre. Et c'est une première étape essentielle dans cette transition de la vie des femmes.
Quelles hormones évoluent pendant la périménopause et comment ?
La périménopause, c'est avant tout une transition hormonale. Contrairement à l’idée d’une « panne sèche » des hormones, c’est plutôt un déséquilibre progressif — avec des hauts, des bas et des montagnes russes. On vous explique quelles sont les principales hormones concernées.
La progestérone : la première à décliner
Première hormone à ouvrir le bal des fluctuations hormonales ? La progestérone. Sa baisse se traduit par des cycles menstruels sans ovulation, plus fréquents dès la quarantaine. Or, même si cette hormone joue un rôle essentiel dans la régulation du cycle menstruel, elle intervient aussi sur :
- le sommeil ;
- l’humeur
- la stabilité émotionnelle.
Donc, forcément, quand elle vient à manquer… On observe :
- des règles plus abondantes ;
- de l’anxiété ;
- une forte irritabilité ;
- un sommeil plus léger.
Souvent, cette baisse peut passer inaperçue dans les bilans hormonaux classiques. Car la progestérone fluctue toujours beaucoup au fil du cycle.
Les œstrogènes : en dents de scie
Les œstrogènes ne chutent pas d’un coup : ils oscillent. Certains mois, leur taux est anormalement haut, ce qui provoque :
- des douleurs mammaires ;
- de la rétention d'eau ;
- des migraines.
D'autres fois, la diminution des taux est drastique, ce qui entraîne :
- de la sécheresse vaginale ;
- des sueurs nocturnes/bouffées de chaleur ;
- une baisse de libido.
Dans tous les cas, cette transition hormonale rend la périménopause déroutante : on se sent très bien un mois, puis submergée le suivant. Bref, le corps tente de compenser, mais… il ne trouve pas toujours le bon équilibre !
La FSH et la LH : les hormones qui s’emballent
La FSH (hormone folliculo-stimulante) et la LH (hormone lutéinisante) sont les « chefs d’orchestre » du cycle menstruel. Quand les ovaires deviennent moins sensibles, le cerveau augmente leur production pour relancer la machine.
Résultat : leurs taux grimpent, parfois fortement. Un taux de FSH élevé est d’ailleurs un indicateur de la périménopause, même s’il ne suffit pas à poser un diagnostic seul. Car ces hormones ne causent pas directement des symptômes… Mais elles témoignent d’un dérèglement ou d'une potentielle phase de transition en cours.
DHEA, testostérone, cortisol : les silencieuses mais essentielles
On parle moins souvent des androgènes (comme la DHEA ou la testostérone). Et pourtant, leur déclin affecte le confort des femmes, notamment :
- leur énergie ;
- leur concentration ;
- leur libido ;
- leur force musculaire.
Le cortisol, hormone du stress, tend aussi à grimper si l’organisme peine à s’adapter à tous ces bouleversements. Quand le système endocrinien est sous pression, le corps donne la priorité à la gestion du stress au détriment des fonctions reproductives. Un phénomène connu sous le nom de « priorité au cortisol », qui amplifie la fatigue et les troubles du sommeil.
Sacré puzzle hormonal, n'est-ce pas ? Mais le comprendre est déjà un premier pas. Car cela vous permet de mieux décoder ses symptômes et de sortir de l’idée que « tout ça, c’est dans la tête ». On vous le redit : c’est bien le corps qui parle à sa façon.
Quels sont les impacts concrets sur le corps des variations d'hormones durant la périménopause ?
Si les hormones orchestrent en coulisses la périménopause, leurs variations ont des répercussions bien visibles… et parfois bouleversantes. Car au-delà des règles irrégulières, c’est tout le corps qui réagit à cette phase de transition.
Le cycle menstruel devient imprévisible
La durée des règles en préménopause, c'est toute une histoire ! Les cycles menstruels s’allongent, se raccourcissent, disparaissent plusieurs mois, puis reviennent en force. Certaines femmes font face à des règles hémorragiques, d’autres à des saignements vaginaux entre les cycles. Bref, faut suivre – et cette absence de repère n'aide pas.
Des douleurs, de la tête aux pieds
Les douleurs aux seins (souvent liées aux pics d’œstrogènes, pour rappel) peuvent devenir plus fréquentes. À cela s’ajoutent parfois des douleurs articulaires : on les identifie rarement comme hormonales, et pourtant, elles sont bien présentes ! Certaines femmes évoquent une sensation de raideur matinale ou une gêne persistante dans les genoux, les hanches, les épaules… Bref, on a mal un peu partout, et c'est pas fun.
Le système urinaire et pelvien en première ligne
Les œstrogènes influencent aussi la tonicité des muscles pelviens et l’élasticité des voies urinaires. Résultat :
- incontinence urinaire légère ;
- impression de vessie plus fragile ;
- rapports sexuels plus inconfortables.
Voilà quelques symptômes intimes, dont on parle peu, mais qui pèsent lourd dans le quotidien.
Le fameux « brouillard mental »
Si seulement la périménopause n'était qu'une affaire de corps... Mais non, ce serait trop facile ! Beaucoup de femmes décrivent aussi expérimenter une sorte de « brouillard mental ». Soit une difficulté à se concentrer, à retenir les informations ou à trouver ses mots. Ce n’est pas un signe de dépression ou de burn-out : c’est une manifestation hormonale bien réelle !
Une fatigue qui dépasse la simple « charge mentale »
Les fluctuations hormonales, le sommeil perturbé, la sursollicitation émotionnelle et physique… Tout cela peut provoquer une fatigue profonde, pas toujours soulagée par une bonne nuit. Certaines femmes évoquent une perte d’élan, un besoin de se replier, sans pouvoir mettre de mots dessus.
Des risques invisibles en toile de fond
Cette période s’accompagne aussi d’une augmentation :
- des risques de maladies cardiovasculaires ;
- du risque de fracture ;
- voire de risque de cancers.
Rien d’automatique, bien sûr ! Mais il faut voir cette transition comme un moment charnière pour faire un point sur sa santé globale, ses habitudes de vie et sa prévention.
Périménopause : comment accompagner son corps et ses hormones ?
Vos symptômes deviennent envahissants ? Votre qualité de vie se détériore ? Ne restez pas sans agir ! Car, même si la périménopause n’est pas une maladie, elle peut nécessiter un accompagnement ciblé. Traitement hormonal ou alternatives naturelles ? Voici les options, leurs bénéfices, leurs limites et les risques potentiels à connaître.
Le traitement hormonal de la ménopause (THM)
Encore trop méconnu — voire redouté —, le traitement hormonal reste pourtant l’option la plus efficace pour soulager des symptômes comme :
- les bouffées de chaleur ;
- les sueurs nocturnes ;
- les troubles du sommeil ;
- ou encore le syndrome génito-urinaire (inconfort lors des rapports, sécheresse, infections à répétition…).
Il repose généralement sur une substitution hormonale : œstrogènes seuls ou associés à de la progestérone, selon les cas. On peut le recevoir par voie orale, cutanée (patch, gel) ou vaginale (ovules, crème, anneau vaginal).
Les études les plus récentes (dont celle de Manson JE dans le cadre de la Women’s Health Initiative) ont permis de nuancer les craintes liées au risque de cancers et au risque de maladies cardiovasculaires. Comment ? En montrant que ces derniers dépendent surtout :
- de l’âge de mise en route ;
- du schéma de traitement ;
- et des antécédents de santé.
D'où l’importance d’une approche personnalisée qui évalue le bénéfice - risque pour chaque femme.
Traitement alternatif et complémentaire
Certaines femmes ne peuvent — ou ne veulent — pas recourir au traitement hormonal de substitution. Et on les comprend. Dans ce cas, d'autres solutions peuvent aider à soulager les symptômes de la préménopause :
- compléments alimentaires à base de plantes (actée à grappes noires, sauge, trèfle rouge, maca...) ;
- phytoestrogènes, en accompagnement d’un suivi médical ;
- micronutrition ciblée ;
- traitement antidépresseur à faible dose (parfois prescrit pour les troubles de l’humeur ou du sommeil) ;
- techniques de relaxation (yoga, respiration, cohérence cardiaque…).
Attention : naturel ne veut pas dire anodin ! On vous conseille de toujours vous référer à un avis médical. Surtout en cas d’antécédents familiaux de cancers hormonodépendants ou de thrombose veineuse.
L'importance du mode de vie
Qu’il y ait traitement ou non, les habitudes de vie jouent un rôle central dans cette période. Une activité physique régulière aide à :
- protéger les vaisseaux sanguins ;
- préserver les os (et limiter le risque de fracture) ;
- équilibrer le cortisol.
Essayez aussi d'adopter une alimentation équilibrée. Ainsi, vous gérerez mieux vos apports caloriques et vous éviterez la diminution des dépenses énergétiques typique de cette phase.
Bien sûr, on n'oublie pas non plus le soutien émotionnel, déterminant pendant ces années de transition !
Bref, la périménopause marque une transition hormonale importante dans la vie des femmes — parfois silencieuse, souvent déroutante, mais jamais anodine. En comprendre les mécanismes, en reconnaître les signes, c’est déjà reprendre du pouvoir sur cette période ! Car non, ce n’est pas « dans votre tête ». C'est dans votre corps, dans vos hormones, et vous avez le droit d’être informée, accompagnée et soutenue.